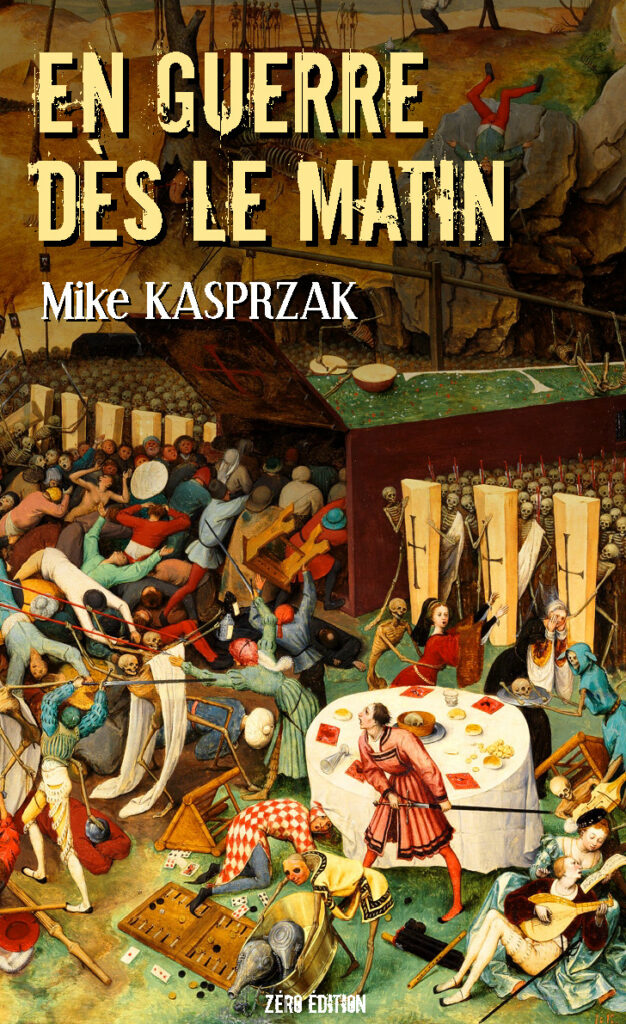Une nouvelle écrite pour un concours sur le thème « nature sauvage, une nature humaine »
Vers la liberté
Un homme rudimentaire, au caractère simple, fort, comme sculpté dans le bois le plus dur, marchait depuis plusieurs jours dans une direction que lui seul avait choisie.
Un jour, une rivière se fit entendre au loin, et l’Homme s’arrêta, et prit une poignée de terre qu’il émietta entre ses doigts calleux en hochant de la tête. Il jugea que l’endroit était bon, et qu’il avait parcouru suffisamment de distance loin des villes, et posa enfin son lourd sac sur le sol.
Au milieu de ces immenses étendues sauvages, de ces landes inhabitées, repoussantes et hostiles, il n’était qu’une tache, insignifiante, blême, perdue, mais l’Homme avait une confiance en lui inébranlable.
Depuis des mois, les pionniers s’étaient rués de toutes parts dans les coins inhospitaliers de la Norvège, désireux d’en découdre avec la nature, de prendre en main leur destin, de faire surgir la vie là où personne ne l’attendait. C’était une véritable ruée vers la liberté. Si bien peu d’entre eux réussirent à tenir plus de quelques mois, les nouvelles encourageantes entendues à propos de son cousin Isaak conduisirent l’Homme à se lancer lui aussi dans cette aventure. Il avait réuni tout le matériel nécessaire, emporté des graines de pommes de terre, des grains de toutes sortes de céréales, des outils affûtés, quelques réserves de nourriture, et une épaisse peau de chamois pour les nuits froides et longues qu’il allait devoir affronter. Mais l’Homme se sentait prêt.
Il déballa les affaires de son sac, sortit sa hache et décida de se mettre immédiatement à l’ouvrage. Il se trouvait à quelques centaines de mètres de la rivière, à l’ouest une multitude de bouleaux, aux troncs blancs comme la craie et aux feuilles foncées s’étendaient à perte de vue, à l’est, ce n’était qu’une vaste plaine ocre, faite de tourbe, et de mousse, plus loin des marécages montraient que l’endroit était riche en humidité et que, si la terre était aussi bonne qu’il l’avait jugée, il pourrait avoir des plantations dès la première année.
L’Homme savait que son salut résidait dans le bois, et que le bois ne tomberait que par la force et que son salut ne tenait donc que dans ses bras. Et l’Homme était grand, costaud, capable d’un labeur des jours durant, et n’avait peur de rien, sinon des ours. Il savait que les loups n’étaient pas une menace, tant qu’il aurait du feu, mais les ours étaient sa principale crainte, surtout en cas d’attaque nocturne. Heureusement il savait aussi qu’il n’y avait que très peu d’ours par ici, et l’Homme flanqua un premier coup de hache dans le tronc d’un jeune bouleau, qui tomberait quelques minutes plus tard.
Il passa la journée à abattre des arbres et à fendre des bûches, conscient qu’il devait dès à présent préparer le plus de bois pour tenir l’hiver. L’hiver, surtout le premier, était sa hantise. S’il réussissait à passer ce premier hiver, il savait qu’il serait sauvé, qu’il serait là pour toujours, qu’il aurait imposé sa marque sur ce lieu, qu’il l’aurait dompté. Au bout de quelques jours, il avait déjà abattu de nombreux arbres.
La nourriture était sa deuxième crainte, moins que le bois, car le bois c’est la vie se disait l’Homme. Lors de son trajet jusqu’à cet endroit, il avait vu passer des lièvres et même des cerfs, la rivière lui fournirait de quoi pécher, et l’endroit regorgeait de baies et la terre était bonne. Dès les premiers jours, il avait mis au sol ses plants de pommes de terre, se disant qu’avec un peu de chance il aurait de quoi récolter d’ici quelques mois, mais il lui fallait aussi faire face à l’hiver, comme pour le bois. C’est l’hiver qui était vraiment l’ennemi de l’Homme et il devait se préparer. Il planta ce qu’il avait de graines et de germes, et construisit une sorte de hutte avec le bouleau fraîchement coupé. Il arracha des tapis de mousse qui poussait en abondance et les utilisa pour en faire une protection, et espérer y conserver de la nourriture.
Des jours passèrent ainsi pendant lesquels l’Homme se mettait à l’ouvrage à chaque instant, abattant des arbres, défrichant les lieux pour faire apparaître cette terre sombre et fertile qu’il avait sous les pieds, chassant et péchant, séchant la viande et le poisson. Pendant tout ce temps il vit pousser des tiges et des feuilles d’un vert éclatant, signe que ses pommes de terre poussaient bien et un matin, alors que ces mêmes tiges et ces mêmes feuilles étaient en train de flétrir et de jaunir, il décida de creuser le sol et récolta de nombreux tubercules gros comme un poing. C’était un trésor.
Son labeur commençait à porter ses fruits, et l’endroit auparavant hostile, repoussant et sauvage, était maintenant marqué de l’empreinte de l’Homme. Il avait à sa disposition un stock de bois conséquent, un endroit parfait pour conserver sa nourriture et une petite maison rudimentaire, faite de poutres de bouleau, d’un toit de mousse et tapissée d’une boue ferme, lui offrait de quoi espérer passer l’hiver.
Mais l’Homme éprouvait également un sentiment nouveau qu’il n’avait encore jamais ressenti depuis qu’il était arrivé. Le soir quand le soleil se couchait derrière les montagnes pointues, et que le travail n’était plus possible et que l’Homme restait seul près de son feu, entouré de la nuit et des ténèbres, et que plus un bruit sinon le murmure lointain de la rivière, quelques cris de chouettes ou d’autres animaux diurnes, mais rares, se faisaient entendre, la solitude lui serrait le cœur. Et le doute s’installait dans ce cœur solitaire et l’Homme se demandait si c’était vraiment une bonne idée, s’il ne ferait pas mieux de repartir vers les villes et trouver un emploi quelconque dans les mines ou la construction de ces nouvelles routes qui émergeaient partout dans le pays. Mais il se reprenait vite, car il venait de ces villes, et de ces mines, et se sentait étranger quand il voyait ces routes et même ces nouveaux véhicules à vapeur qui faisaient un bruit monstrueux et qui le répugnait. Il était venu ici pour être libre, et il tenait dans cette solitude, et ce crépitement du feu et ces rares bruits de chouettes ou d’autres animaux diurnes, cette liberté qu’il avait tant recherchée.
Les premiers jours de froid arrivèrent plus rapidement que prévu et les premiers flocons tombaient sur le sol recouvrant le paysage d’un tapis blanc. Les journées raccourcirent soudainement, et le climat changea avec une rigueur si brusque que l’Homme fut heureux d’avoir travaillé avec le plus d’acharnement possible jusqu’alors. Le froid rendit la terre plus dure et de moins en moins facile à travailler, les animaux se firent plus rares, la végétation devint soudain terne, froide, comme un visage cruel vous incitant à déguerpir. Mais l’Homme ne doutait toujours de rien et continuait à bécher le sol, à couper des arbres, à chasser et à pécher, mais pour quel résultat ?
S’il se doutait que l’hiver serait l’épreuve la plus redoutable, il n’imagina pas que son corps et son esprit s’accableraient aussi vite. Un après-midi alors que le soleil était déjà en tain de se coucher au cœur de deux montagnes, comme lové entre les deux seins d’une mère, l’Homme se prit à trembler des mains, non pas seulement à cause du froid, mais de la douleur. Il tourna les paumes vers lui et se rendit compte à quel point il avait esquinté son corps. Des engelures lui coupaient les doigts, des ecchymoses partout coloraient sa peau d’une teinte vermeille, des boursouflures montraient le contact permanent qu’avait eu sa chair avec les manches des outils et les écorces des arbres. Était-il temps pour lui de faire une pause ? À un tel moment ? La rigueur du climat et l’obscurité trop fréquente ne lui permettaient de toute manière pas d’aller plus loin. L’hiver était là !
Les journées étaient de moins en moins productives, de plus en plus monotones et éprouvantes. L’Homme passait le plus clair de son temps à l’intérieur de sa hutte rudimentaire, mangeait peu, allumait un feu dès que le soleil se couchait, et l’entretenait pendant des heures. Le stock de bois, bien que fruit d’un labeur sincère, diminuait à vue d’œil. L’Homme restait de longues heures assis sous sa hutte à proximité du feu à se réchauffer et à se poser des tonnes de questions. La nature environnante avait, elle aussi, changé au fil des saisons et l’hiver avait semblé éteindre toute vie. Nul lièvre, nulle perdrix ne se montrait plus. La rivière était partiellement gelée et n’émettait plus qu’un fin murmure sourd presque indicible. Or le crépitement du feu, aucun son, aucun bruit, aucun souffle ne faisait entendre. L’Homme était seul. Il se demandait parfois s’il ne ferait pas mieux de rebrousser chemin, et de simplement revenir au printemps, mais quelle sorte d’homme serait-il alors ? S’il voulait dompter l’endroit, il devait se montrer fort, et il l’avait été jusqu’à présent. Tous ces travaux entrepris, toute cette terre retournée, tous ces arbres abattus. Tous ces projets. S’il n’avait pas encore réussi à aboutir à tout ce qu’il avait en tête, il savait qu’il n’en était pas loin, qu’il avait déjà avancé tant qu’il le pouvait, sans fléchir, sans exprimer le moindre signe de relâchement, montrant à la nature et à ce monde qu’il n’était pas un faible. Mais tout pouvait s’arrêter, par un abandon prématuré ou par la mort. Mourir ici ? Lui ? Non il n’en était pas question. L’Homme pour se donner de la force pensait au futur, pensait au printemps, pensait à tout ce qu’il aurait à faire une fois l’hiver terminé, et surtout à tout ce qu’il pourrait faire. Le cousin d’après les nouvelles, s’était marié à une autochtone. Des groupes de chasseurs vivaient encore plus loin dans les montagnes. Si aucune âme ne s’était montrée jusqu’alors, peut-être cela viendrait-il plus tard, pensait l’Homme. Il se voyait déjà peut être vivre ici, avec une femme et des enfants, agrandir la maison, construire d’autres habitations, élever des animaux peut-être retourner de temps en temps au village chercher des poules, planter d’autres graines, se marier, bâtir un moulin et moudre de la farine, aller à la pêche avec son fils, oui, mais pour le moment ce n’était que la nuit, le froid, le silence partout, la mort qui guettait, blanche et sans pitié. Et l’Homme, cette force de la nature, voyait son énergie, ses vivres et son bois, diminuer de jour en jour.
Juste tenir.
Juste passer l’hiver.
Un soir, tandis qu’il réchauffait près du feu son corps amaigri et emmitouflé sous sa peau de chamois usée, de l’autre côté de la rivière, l’Homme vit passer des silhouettes. Avec l’obscurité régnante, et un faible clair de lune, il ne put distinguer de quoi il s’agissait. Des autochtones, se dit l’Homme, sans doute porté par un maigre espoir qu’on puisse lui venir en aide. Les silhouettes ne bougeaient plus désormais et lui faisaient face. Il regardait dans leur direction, attendant peut-être un signe ou un appel, tandis que la rivière murmurait sous la glace et qu’une brise froide balayait les environs. Puis un hurlement lointain, suivit d’un deuxième lui firent comprendre qu’il n’y avait aucune main prête à lui être tendue, aucun être sur le point de l’aider. Il n’y avait là qu’une meute de loups, regardant l’Homme de loin, regardant le feu qui le protégeait et les loups et l’Homme se firent face à distance, sans qu’aucun ne montre de signe de peur, dans un respect mutuel, mais précaire. L’Homme savait qu’à ce moment il ne risquait rien, que sous cette nuit et cette lune faible et cette brise glaciale, les loups ne faisaient que lui montrer qu’ils étaient là, enfouis dans l’obscurité et les ténèbres, et qu’ils attendaient seulement le premier signe de faiblesse pour rappeler à l’Homme que cette nature qu’il voulait dompter n’aurait aucune pitié s’il montrait qu’il n’en était pas digne. L’Homme resta éveillé toute la nuit, alimentant le feu au fur et à mesure qu’il se consumait et n’avait qu’une chose en tête : passer cet hiver et montrer qu’il était bien digne de ses ambitions.
Des jours plus tard, alors que l’Homme se réveilla d’une nuit éprouvante, de cauchemars terribles et de la certitude que c’était là sa dernière nuit sur cette terre et qu’il n’aurait finalement été que le pantin de cette nature sauvage et indomptable, il sentit dans tout son corps une certaine douceur le recouvrir. Oui, des gouttes d’eau coulaient des feuilles des arbres, de la neige, en train de fondre, des bourgeons apparaissaient çà et là, la verdure semblait sortir timidement de sous la couverture de neige qui avait encore l’air éternelle la veille.
L’Homme se releva avec difficulté, des douleurs dans tous les membres, et observa ce spectacle de la nature changeant sous ses yeux, ce bruit sourd des gouttes qui tombaient sur le sol encore dur, la lumière éclatante du soleil qui réfléchissait sur cette couche de neige en train de disparaître. Au loin, sous les montagnes, un lièvre dévalait au-dessus des buissons qui bientôt donneraient de la nourriture nouvelle.
Au milieu de ces immenses étendues sauvages, de ces landes inhabitées, repoussantes et hostiles, il y avait maintenant un champ prêt à être cultivé, des habitations rudimentaires, mais solides, et un homme, qui regarda l’horizon avec un espoir nouveau et de la force dans les yeux.
C’était le printemps !